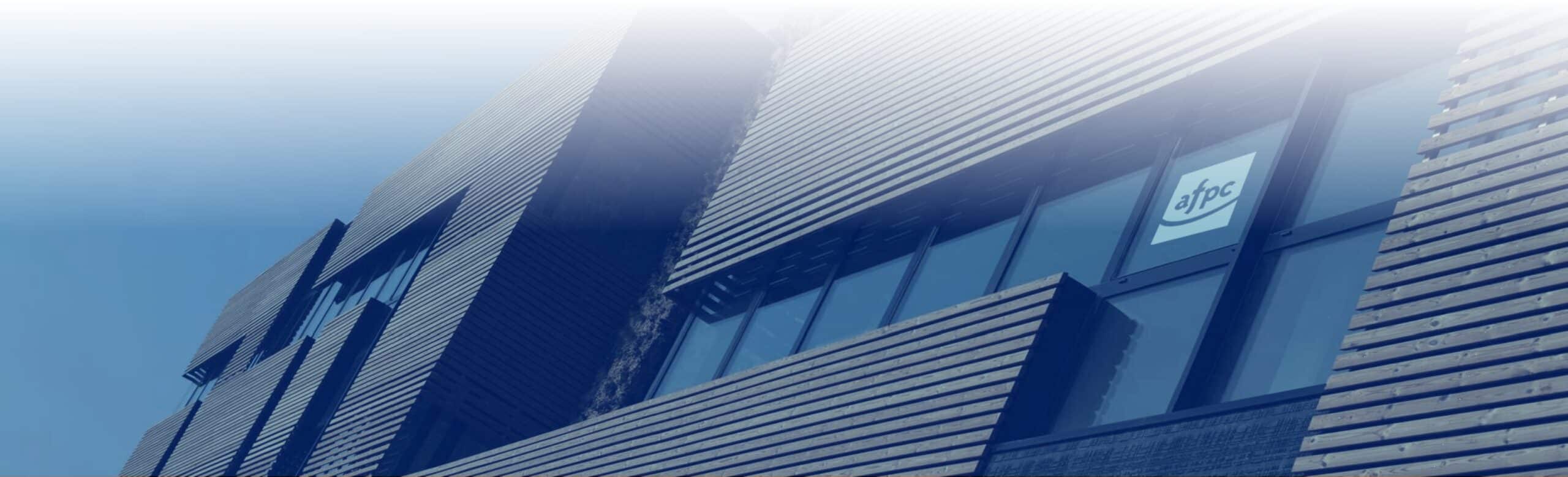
Enjeux éthiques de la contention physique en santé mentale
La contention physique est très présente dans la filmographie lorsque des scènes sont tournées dans des hôpitaux psychiatriques. En tant que soignant ou futur soignant, vous savez que cette pratique est loin d’être systématique. Elle doit même relever de l’exceptionnel tant elle a d’impact sur la santé mentale et psychique des individus qui la subissent. C’est un sujet épineux qui soulève des questions éthiques sur la dignité humaine et la liberté d’aller et venir. Des droits humains fondamentaux qui doivent être préservés à tout prix dès que la situation le permet. Découvrez avec nous, dès à présent, les enjeux et les risques de la contention. Et apprenez comment les réduire en choisissant les meilleures alternatives.
Guide de lecture
Qu’est-ce que la contention physique et pourquoi est-elle utilisée ?
La contention physique désigne des méthodes manuelles, mécaniques ou matérielles pour restreindre les mouvements d’un individu. Elle empêche également ses déplacements. Son but est de prévenir un danger immédiat, que ce soit pour le patient ou pour son entourage. Mais elle doit rester une pratique exceptionnelle, toujours encadrée et réalisée dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité des hommes. Il existe plusieurs formes de contention. On distingue :- Les contentions physiques ou mécaniques ;
- Chimiques ;
- Psychologiques ;
- Une sécurisation excessive de l’espace avec des barrières ou des équipements ;
- La restriction du droit de sortie;
- Une surveillance constante, que ce soit par vidéo ou des contrôles réguliers ;
- Des injonctions répétées, comme « restez assis » ou « ne bougez pas ».
La contention physique : le cadre légal et réglementation
La législation de la contention est encadrée par les articles L.3211-3 et L.3222-5-1 du Code de la santé publique. L’article L.3211-3 précise que toute restriction de liberté en soins psychiatriques doit être adaptée à l’état de la personne concernée, et mise en œuvre dans le respect de sa dignité. L’article L.3222-5-1 rappelle que la contention doit rester une solution de dernier recours. Elle ne peut être utilisée que s’il y a un danger immédiat. Sa durée est limitée à six heures. Au-delà, elle doit être réévaluée avant d’être éventuellement prolongée.Les bonnes pratiques en santé mentale et gériatrie
Les recommandations professionnelles complètent le cadre légal et orientent les bonnes pratiques. La Haute Autorité de Santé insiste sur le fait que la contention doit rester exceptionnelle. Elle recommande une évaluation rigoureuse des risques de la contention et encourage en priorité la mise en place d’alternatives non contraignantes. La Société Française de Gériatrie et Gérontologie conseille une utilisation très prudente de la contention en gériatrie. Ceci seulement après avoir exploré toutes les autres options possibles. Pour finir, l’Agence nationale de Sécurité des médicaments et des produits de santé souligne l’importance de la formation continue des soignants pour garantir une utilisation réfléchie et responsable de cette pratique.Vos risques dans le cas d’une pratique de contention abusive
En utilisant la contention de manière excessive ou injustifiée, le patient n’est pas le seul à être exposé à des risques ; vous vous exposez aussi à des risques. Si un patient est blessé, l’établissement de santé ou le(s) professionnel(s) pourraient être tenus responsables et devoir réparer le préjudice subi (article 1240 du Code civil). Un abus peut aussi entraîner des poursuites pénales pour violence sur une personne vulnérable d’après l’article 222-13 du Code pénal. Aussi, une contention injustifiée porte atteinte à la dignité et aux droits des patients. Une atteinte aux droits fondamentaux peut entraîner des sanctions professionnelles, comme une sanction disciplinaire par l’employeur ou une suspension ou une radiation par le Conseil de l’Ordre. Enfin, si la contention est systématique ou mal documentée, votre établissement pourrait faire face à des contrôles renforcés et perdre sa certification.Quand et comment mettre en œuvre la contention physique ?
La contention physique restreint les mouvements pour des raisons de sécurité ou de soins. Toutefois, elle soulève des interrogations sur les méthodes employées et leurs conséquences.Les cas où la contention se justifie
Le recours à la contention physique doit être exceptionnel et justifié par des situations cliniques urgentes. Voici les principales situations qui peuvent justifier son usage :- Garantir le suivi médical : lorsque le patient tente de retirer des dispositifs médicaux essentiels, comme des perfusions ou des sondes ;
- Prévenir les blessures : en cas de chutes récurrentes ou de déambulations incontrôlées, qui présentent un risque pour la sécurité du patient ;
- Assurer la sécurité des individus : lors de crises aiguës, d’attitudes agressives ou de comportements violents, où la sécurité du patient ou de l’entourage est menacée.
Le protocole de contention à suivre
Le recours à la contention physique doit suivre un protocole rigoureux pour garantir la sécurité et le respect du patient. Voici les étapes essentielles :- Évaluation préalable à la contention Avant toute contention, une évaluation rigoureuse de la situation clinique permet de déterminer si une telle mesure peut être prise. Cette analyse considère des alternatives à la contention et des risques pour la sécurité du patient.
- Application de la mesure de contention La contention doit être appliquée de manière proportionnée et respecter la dignité du patient. Aussi, elle doit être réalisée par du personnel soignant formé et utiliser des dispositifs appropriés.
- Suivi médical continu Pendant l’application, un suivi médical régulier permet d’évaluer son efficacité et la tolérance du patient. En fonction des résultats obtenus, une adaptation des mesures peut être réalisée.
- Traçabilité et documentation Tous les actes doivent être minutieusement enregistrés. Ceci inclut la justification, la durée et l’évaluation régulière de la situation pour justifier une conformité avec les exigences légales.
- Communication avec le patient et ses proches Instaurer un dialogue sur la contention avec la famille et le patient sur la raison, la durée et le suivi post-intervention. Ceci dans l’optique d’éviter des impacts sur la relation soignant-soigné.
- Suivi post-application de la contention Après la levée de la contention, une évaluation des impacts psychologiques, physiques, et un retour d’expérience patient permettent d’ajuster les pratiques pour le futur.
Les conséquences de la contention sur la santé physique et psychologique
La contention physique passive comporte de nombreux risques pour la santé physique, psychologique et sociale des patients. Ces effets peuvent se manifester à court ou long terme :- Sentiment d’exclusion : isolement, baisse d’autonomie et de respect ;
- Troubles du comportement : nervosité, repli, dépression ;
- Problèmes physiques : constipation, diarrhée, fonte musculaire, fragilisation osseuse, escarres ;
- Dépendance accrue : renforcement de la dépendance vis-à-vis des soignants ;
- Perte de dignité et traumatisme psychique : privation de liberté et dévalorisation ;
- Risque de strangulation : dispositifs mal utilisés pouvant entraîner des accidents graves ;
- Aggravation des troubles cognitifs : intensification de l’agitation, confusion et agressivité, troubles anxieux ;
- Complications liées à l’immobilisation : incontinence, contractures, sarcopénie, déshydratation ;
- Infections nosocomiales liées à l’immobilisation prolongée ;
- Prolongation de l’hospitalisation ;
- Augmentation de la mortalité.
Limiter et prévenir les recours à la contention
Limiter la contention est essentiel pour préserver le bien-être et la dignité des patients. Voici des stratégies clés pour la prévenir :- Formation sur la contention : sensibiliser les soignants à la gestion de crise, aux alternatives et à la communication avec du contenu informatif ;
- Stratégies de désescalade : utiliser l’écoute active, l’apaisement verbal et la gestion des émotions pour réduire l’agitation ;
- Évaluation régulière : suivre et réévaluer constamment les besoins des patients pour éviter les recours systématiques ;
- Aménagement de l’environnement : créer un cadre sécurisé adapté pour prévenir les crises ;
- Pratiques de contention alternatives : recourir à des approches comme la relaxation, la musicothérapie ou l’accompagnement psychologique (voir l’article “Les alternatives à la contention”) ;
- Renforcement du travail d’équipe : favoriser la collaboration et partager des stratégies efficaces.
Ressources officielles
- Article L.3211-3 du Code de la santé publique
- Article L.3222-5-1 du Code de la santé publique
- Article 1240 du Code civil
- Article 222-13 du Code pénal
- Article de la Haute Autorité de santé
- Etude de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie
- Dossier d’actualité de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament
